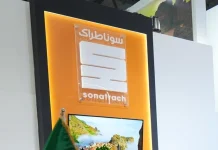Le directeur général du cluster Green Energy Algeria, Boukhalfa Yaïci, est intervenu, ce mardi 1er juillet 2025 sur les ondes de la Radio Chaîne 3, pour faire le point sur le programme algérien de développement des énergies renouvelables, en particulier le solaire.
Il a rappelé que le programme national vise « 15 000 mégawatts d’énergie renouvelable à l’horizon 2035 », principalement issus du solaire. Un premier appel d’offres, lancé en février 2023. Les contrats ont été signés en mars 2024. Le projet porte sur « la réalisation de 3 200 mégawatts », répartis en trois tranches (2 000, 1 000 et 200 mégawatts). La durée de réalisation est entre 10 et 24 mois.
Actuellement, les entreprises adjudicataires sont sur les chantiers. Toutefois, « il y a eu un travail très important qui a été fait au niveau des études » et selon lui, « ça avance ». Néanmoins, il souligne que certaines difficultés persistent, notamment parce que « toutes les parties prenantes n’étaient pas préparées » au lancement du programme.
Le retard dans la préparation des entreprises s’explique, selon M. Yaïci, par l’absence prolongée de projets dans le secteur : « il n’y avait pas de visibilité » jusqu’à fin décembre 2022, moment où le président de la République a décidé de relancer le programme. Il explique que « tant qu’un contrat n’est pas signé, une entreprise ne peut pas investir », ce qui retarde la mise en œuvre.
Il rappelle également que des entreprises algériennes ont décroché « environ 30 % du marché » des 3 200 mégawatts. Mais plusieurs d’entre elles sont confrontées à une rude concurrence étrangère et à des contraintes techniques. Certaines ont même cessé leur activité.
« Il y avait des industriels qui avaient investi dans la production de panneaux solaires à l’appel des pouvoirs publics. A l’époque, le programme des énergies renouvelables était conditionné par des investissements industriels. Les investisseurs qui se sont lancés dans ce domaine se sont retrouvés avec des capacités de production de panneaux solaires alors qu’il n’y avait pas de marché. Ces entreprises qui avaient contracté des crédits bancaires se sont retrouvées coincées pour le remboursement », a-t-il rappelé.
« Par la suite, quand il y a eu les appels d’offres lancés en 2023, il a y avait des exigences au niveau des cahiers des charges qui demandait une puisse beaucoup plus grande que celle qui est disponible localement », selon M. Yaïci, qui précise que « les entreprises étaient capables de fournir jusqu’à 410 watts par panneau, alors que dans le cahier des charges on devait être autour de 560 voir plus de 600 watts pour être compétitifs. »
Une production locale pénalisée
Il regrette aussi que le décret exécutif de 2020, censé soutenir la production nationale de panneaux solaires, « n’a jamais été mis en œuvre ». Le décret prévoyait « un taux de droit de douane réduit à 5 % pour les intrants des panneaux photovoltaïques », à condition d’assurer un taux d’intégration local de 20 %. Mais « les conditions d’application n’ont jamais été définies », souligne-t-il. Résultat : il est aujourd’hui plus avantageux d’importer des panneaux solaires complets que de produire localement.
M. Yaïci appelle à « ouvrir de nouveaux segments de marché », notamment dans l’agriculture et l’industrie, où des installations plus petites pourraient suffire : « on peut avec 410 watts fournir une installation pour un agriculteur ».
La concurrence étrangère est accentuée par les accords de libre-échange, notamment avec l’Union européenne, la Tunisie et la Jordanie, qui rendent certains produits importés « exonérés de droits de douane ». De son côté, la Chine vend à bas prix grâce à une surcapacité de production.
Pour M. Yaïci, le coût ne doit pas être le seul critère : « l’enjeu est important », dit-il, car il s’agit aussi de « réduire la consommation de gaz naturel » et de « décarboner l’économie ». Il évoque les nouvelles exigences européennes en matière de contenu carbone des produits importés.
Plusieurs textes réglementaires ne sont toujours pas appliqués. Il cite un décret de 2017 qui autorise les appels d’offres en modèle IPP (producteurs indépendants d’électricité), mais qui reste en suspens faute de cadre clair. « Il faut commencer par appliquer les décrets qui existent », estime-t-il, avant de les ajuster ou d’en créer d’autres.
M. Yaïci insiste sur le besoin de stabilité : « il faut donner de la visibilité à toutes les parties prenantes », notamment aux investisseurs, pour éviter les blocages liés aux changements de tutelle ou aux révisions réglementaires fréquentes.
Et après les 3 200 MW ?
Un autre point préoccupant est l’absence de perspective claire au-delà du programme actuel. « C’est la question que tout le monde se pose », dit-il. Il estime que les pouvoirs publics doivent « préparer dès à présent l’après-3200 mégawatts », pour permettre aux acteurs économiques de s’y projeter.
Il appelle à « associer davantage d’entreprises locales », y compris issues du secteur pétrolier et gazier, et à explorer les financements mixtes – publics et privés. Il juge encourageant l’intérêt manifesté par des investisseurs étrangers depuis l’adoption de la loi de finances 2025, qui autorise le recours à des financements internationaux.
Selon lui, le modèle IPP permettrait d’attirer des développeurs qui « ramènent le financement et réalisent le projet », contrairement au modèle EPC (clé en main) actuellement dominant. Il propose aussi de « créer de nouveaux modèles économiques » à travers de petits projets solaires locaux, notamment pour l’agriculture saharienne, afin d’éviter de tirer des lignes électriques sur de longues distances.
« On peut créer des producteurs indépendants qui vendent de l’électricité aux agriculteurs », dit-il, en précisant que cela ne nécessite pas « des financements importants ». Ces petites installations seraient accessibles à de nombreuses entreprises locales.
Il conclut en appelant à « élargir et approfondir la stratégie actuelle », en tirant les leçons du programme en cours et en évitant une « coupure nette » après les 3 200 mégawatts. « Le 3200 MW est une vraie école, mais il ne faut pas refaire les mêmes erreurs », dit-il.
L’enjeu de l’hydrogène vert
Concernant l’hydrogène vert, Boukhalfa Yaïci appelle à « adopter une position claire et visible à l’international ». Il évoque le projet SoutH2 Corridor, qui implique plusieurs pays européens et nord-africains, comme une opportunité à saisir.
Il estime que « le gros de la production d’hydrogène vert se fera en Algérie », car elle dispose du soleil, de l’espace et de l’eau. Il appelle les partenaires européens, notamment l’Allemagne, à « investir en Algérie » pour soutenir cette production, tout en soulignant que le coût élevé de l’hydrogène vert reste un obstacle sans soutien financier.
Face aux évolutions rapides à l’échelle mondiale, notamment les nouvelles barrières carbone imposées par plusieurs pays, M. Yaïci alerte sur le risque de ne plus pouvoir exporter certains produits, comme les dattes ou d’autres marchandises utilisant de l’énergie fossile pour leur production.