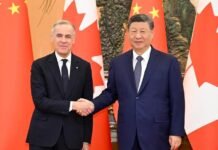Plus de quinze ans après l’instauration de la monnaie unique, le débat est relancé à Bruxelles et dans les capitales européennes sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement de la zone euro.
Profitant de l’amélioration de la conjoncture économique, Bruxelles et les Etats membres cherchent à tirer les leçons des violents soubresauts financiers qui ont mené la Grèce au bord d’une sortie de la zone euro à partir de 2010, et ont fait douter de la cohésion même de l’union monétaire, qui réunit aujourd’hui 19 Etats sur les 28 que compte l’Union Européenne (UE).
Institutions et Etats doivent aussi faire face au désenchantement d’une partie de la population, inquiète des effets de la mondialisation et tentée par le repli sur l’espace national.
L’épisode du Brexit a montré qu’un peuple pouvait très bien rompre son engagement européen si celui-ci ne lui apporte pas satisfaction
Ces derniers mois, le président français Emmanuel Macron, qui veut incarner un nouveau projet européen, a multiplié les discours en faveur de réformes à la fois de l’Union des 28, et du cercle plus restreint de la zone euro.
« L’enjeu qui est le nôtre au coeur de la zone euro, c’est de savoir comment nous arrivons à faire de cette zone une puissance économique concurrente de la Chine et des Etats-Unis et c’est comment nous arrivons à résoudre ce que depuis dix ans nous échouons à faire, créer de l’emploi », avait déclaré en septembre le président français.
Avec un Produit intérieur brut (PIB) de 11.934 milliards de dollars (environ 10.788 milliards d’euros) pour 2016, le poids de la zone euro est comparable à celui de la Chine (11.199 milliards de dollars) mais reste derrière les Etats-Unis (18.624 milliards), selon les données de la Banque mondiale.
Mais l’idée de réformer la zone euro fait l’objet de discussions tendues entre les pays concernés.
Ceux du Nord, comme les Pays-Bas et l’Allemagne, première puissance économique européenne, se montrent réticents à mutualiser des richesses avec des pays du Sud, tels que la France, l’Italie ou l’Espagne, dont ils jugent la politique budgétaire trop laxiste.
Ils préfèrent se concentrer sur des réformes plus techniques destinées principalement à assurer un meilleur respect des règles du pacte de stabilité européen (déficit public sous les 3% du PIB, endettement public inférieur à 60% du PIB…), considérées comme le meilleur rempart contre de futures crises financières.
La Commission européenne tente de trouver une voie de compromis, et a proposé le 6 décembre un paquet de mesures comprenant notamment la création d’un Fonds monétaire européen et l’institution d’un ministre des Finances de la zone euro.
A l’issue d’un sommet européen le 15 décembre, la chancelière allemande Angela Merkel, en pleines négociations pour former un gouvernement, ne s’est pas montrée fermée à la discussion sur les propositions du président français.
« Nous allons trouver une solution commune, car c’est nécessaire pour l’Europe », a-t-elle dit. « Quand on veut, on peut », a-t-elle insisté.
Le président français Emmanuel Macron s’est fait le champion d’un futur budget pour la zone euro, qu’il souhaite conséquent, représentant « plusieurs points de PIB » de la zone.
Ce budget pourrait être financé par des « taxes européennes dans le domaine numérique ou environnemental » avant peut-être qu’un jour un impôt sur les sociétés harmonisé ne vienne également apporter sa contribution.
En novembre, un « nombre important » de ministres de Finances de la zone euro se sont prononcés en faveur d’un budget utilisé comme « instrument stabilisateur » en cas de « choc asymétrique », c’est-à-dire un événement qui affecte durement l’économie de l’un des pays de la monnaie unique, sans toucher les autres (par exemple, des inondations catastrophiques).
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, estime toutefois qu’une « ligne budgétaire conséquente » définie dans le cadre du budget de l’Union européenne serait plus adaptée.
Le principal point d’interrogation concerne la position allemande, qui dépendra largement du partenaire de coalition d’Angela Merkel.
Les sociaux-démocrates allemands sont favorables aux propositions du président français, en ce qui concerne la création d’un budget mais aussi celle d’un ministre des Finances.
Le parti conservateur de Mme Merkel, de son côté, n’a pas complètement fermé la porte à un budget, mais attend de voir comment il sera financé et à quoi il servira.
Mme Merkel ne rejette pas non plus l’idée d’un ministre des Finances européen, mais pour elle, le rôle de ce ministre serait de faire appliquer plus efficacement les règles de contrôle de déficit et de la dette.
Après les frictions entre le Fonds monétaire international (FMI) et les pays de la zone euro sur la gestion de la crise grecque, les Européens, y compris l’Allemagne, se sont peu à peu convaincus de la nécessité de se débrouiller seuls à l’avenir et par conséquent de se doter d’un Fonds monétaire européen (FME).
Ce FME serait constitué à partir du Mécanisme européen de stabilité (MES) créé en 2012 après la crise de la dette dans la zone euro, pour pouvoir venir en aide aux pays en difficulté financière en leur faisant des prêts.
La Commission européenne a présenté le 6 décembre un projet de FME qui serait un « organe communautaire », « responsable devant le Parlement européen », et qui aurait la même capacité théorique de prêt, soit environ 500 milliards d’euros.
Mais l’Allemagne s’inquiète de voir diminuer son influence dans le nouvel organisme. Actuellement elle bénéficie dans le MES de droits de vote proportionnels à son apport en capital (27%), qui lui donnent une influence supérieure à celle qu’elle a dans les institutions communautaires.
Le futur FME pourrait également endosser un rôle de garant des banques en difficulté dans la zone euro, au cas où les mesures prévues dans le cadre de l’Union bancaire, également en cours de constitution, ne seraient pas suffisantes.
De tous les projets de la zone euro, ce projet de l’Union bancaire lancé en 2014 est le plus proche d’aboutir. Il s’agit de rendre les banques de la zone euro plus solides et d’éviter que l’argent du contribuable ne serve à sauver des banques en difficulté, comme cela c’était produit pendant la crise.
Pour l’instant, deux des trois piliers prévus ont été mis en place: le premier concerne la supervision des banques et le second est destiné à aider en cas de besoin les banques en difficulté avec de l’argent venu du secteur.
En revanche, le dernier pilier, destiné à rassurer les clients des banques, grâce à une garantie européenne des dépôts, est plus difficile à mettre en place.
Après avoir mis sur la table un premier projet en novembre 2015, la Commission européenne a présenté en octobre dernier une version moins ambitieuse, espérant vaincre les réticences de l’Allemagne, toujours inquiète de voir ses épargnants payer pour des banques du sud qu’elle estime mal gérées.
Quand bien même les pays de la zone euro parviendraient à avancer sur les réformes évoquées ci-dessus, d’autres dossiers cruciaux pour sa cohésion sont sur la table de négociations, comme celui de l’harmonisation fiscale, qui concerne l’ensemble des 28 pays de l’Union européenne.
Le débat se focalise notamment sur l’impôt sur les sociétés, économistes, experts et dirigeants politiques prenant peu à peu conscience des effets néfastes d’une concurrence fiscale exacerbée dans une Union où capitaux, biens et personnes circulent librement.
Entre 1995 et 2016, le taux normal moyen de l’impôt sur les sociétés dans l’Union européenne a perdu 14 points, soit une baisse de 33%, selon une étude de l’Observatoire des politiques économiques en Europe dépendant de l’université de Strasbourg. Le débat se cristallise notamment sur les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), les grandes plateformes américaines de l’économie numérique.
Ces dernières concentrent leurs bénéfices dans des filiales domiciliées dans des pays à faible taux d’imposition, comme l’Irlande ou le Luxembourg, même si elles génèrent presque toutes leur chiffre d’affaires dans d’autres pays de l’UE.
Selon la Commission européenne, le taux d’imposition réel sur le bénéfice des colosses du numérique dans l’UE est en moyenne de 9% seulement, tandis que celui des entreprises traditionnelles dépasse les 20%.
Mais la concurrence fiscale fait aussi sentir ses effets dans l’économie classique, comme le montre la procédure lancée lundi 18 décembre par Bruxelles contre Ikea. Le géant suédois du meuble est soupçonné d’avoir bénéficié d’avantages indus aux Pays-Bas via le système du rescrit fiscal, qui permet une taxation « à la tête du client », négociée entre l’entreprise et l’administration fiscale. D’autres sociétés de l’économie classique ont été épinglées dans le passé par la Commission européenne, dont Starbucks aux Pays-Bas ou Fiat au Luxembourg.
En octobre 2016, la Commission européenne a relancé un projet visant à instaurer des règles uniformes de calcul des bénéfices, l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (Accis). Avec ce système, qui serait obligatoire pour les groupes au chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros, les Etats resteraient libres de définir le taux d’imposition, mais ils détermineraient tous de la même manière l’assiette de cet impôt. Il n’y aurait qu’un seul lieu d’imposition mais le produit de la taxe serait ensuite réparti dans tous les pays où la société exerce une activité, en fonction du niveau de l’activité dans chaque Etat, plutôt que selon les résultats des filiales.
Ce projet d’Accis doit encore être approuvé par les Etats membres et le Parlement européen. Mais dans l’Union, toute réforme en matière fiscale est difficile, car elle doit être décidée à l’unanimité des 28 pays.
Afp