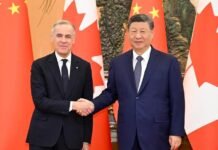Dénigrée par les néolibéraux, vénérée par les économistes qui prônent l’interventionnisme de l’Etat: l’œuvre de l’économiste John Maynard Keynes (1883-1946) entre le 1er janvier dans le domaine public et suscite toujours autant de débats.
« Pour Keynes, l’économie doit être mise sur le siège arrière de la voiture », affirme à l’AFP Henri Trubert, PDG des éditions « Les Liens qui libèrent », qui publient le 11 janvier « La lettre à mes petits enfants », un court ouvrage de l’économiste britannique.
« Or, depuis 25 à 30 ans, l’économie a pris le volant. Aujourd’hui, elle gouverne et toute décision politique est prise en fonction de l’économie et des théories économiques », regrette l’éditeur, convaincu du « bien fou » que procure encore aujourd’hui la lecture de l’oeuvre de Keynes.
Plus de huit ans après le début de la crise, ses idées suscitent encore des débats enflammés entre économistes, de la relance de la croissance par la dépense publique à l’Etat providence, ou encore le contrôle des flux des capitaux ou ses réticences face à la mondialisation financière.
Keynes, réputé à tort d’avoir été l’instigateur du New Deal aux Etats-Unis, lancé avant la publication en 1936 de son oeuvre majeure « La théorie générale », ne jugeait pas la finance comme son ennemi, mais il appelait à s’en méfier fortement. « Du point de vue de la pensée, avec cette vision d’un régime du capitalisme qui n’est plus celui du laisser-faire, il a été extraordinairement anticipateur et puissant dans son analyse », explique à l’AFP André Orléan, directeur d’études à l’Ehess, qui signe la préface de la lettre aux petits-enfants.
Des principes pourtant battus en brèche par le triomphe du néolibéralisme dans les années 1980 avec l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan aux Etats-Unis et de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, au point que Keynes est devenu presque un gros mot pour les économistes qui prônent l’autorégulation des marchés. « L’idée de l’ajustement par les marchés est alors revenue en force et sa vision du régime capitaliste est devenue tout à fait dénigrée », reconnaît M. Orléan.
Mais ses idées vont plus loin que les remèdes de sortie de crise. Dans sa lettre à ses petits-enfants, ouvrage publié en 1930 après le krach de Wall Street, au moment où le monde plongeait dans la grande dépression, il évoquait déjà la diminution du temps de travail ou le défi de l’automatisation.
« Dans son esprit, le travail allait devenir inutile, parce que les besoins seraient satisfaits par un système hyper-productif », précise M. Orléan. Dans sa lettre, il évoquait même des journées de trois heures. « Quand l’accumulation de richesses n’aura plus grande importance pour la société, d’importants changements se produiront dans notre code éthique », écrivait-il.
Keynes se disait convaincu que le capitalisme arriverait à sa fin, qu’il n’était qu’une période de transition dans l’Histoire, et il se plaignait constamment des « fausses valeurs » portées par ce système comme « l’amour de l’argent pour l’argent », qu’il qualifiait de « morbide », répugnant » et « exécrable ». Mais il a aussi lancé un avertissement: « Pour lui, le fait d’avoir moins de durée de travail n’est pas immédiatement un bien. L’humanité nécessite un temps d’adaptation au loisir », affirme M. Orléan.
Keynes apparaît ainsi comme un épicurien, s’inspirant du philosophe George Moore, appelant les générations suivantes à jouir de l’instant présent et prenant ses distances avec l’économie, lui qui a pourtant apporté une contribution décisive aux accords de Bretton Woods en 1944, ceux qui ont jeté les bases du système financier mondial actuel. « Quand on lit Keynes, on se dit qu’il est beaucoup plus novateur que les théories économiques ou les économistes d’aujourd’hui. Au moins lui, il pensait avenir », souligne M. Trubert.
« Les autres sont fixés sur le présent. Il faut plus de croissance, il faut plus d’emplois, plus de travail. Ils sont restés dans cette croyance qui est complètement fantasmée », regrette l’éditeur.
Mais Keynes a commis une « erreur majeure » dans sa lettre. « Il y a un aspect qui lui échappe: l’idée que le capitalisme finirait par disparaître parce qu’il aurait satisfait les besoins des populations », pointe M. Orléan.
Or, le capitalisme a subsisté en imposant de nouveaux besoins, comme la téléphonie mobile.
AFP